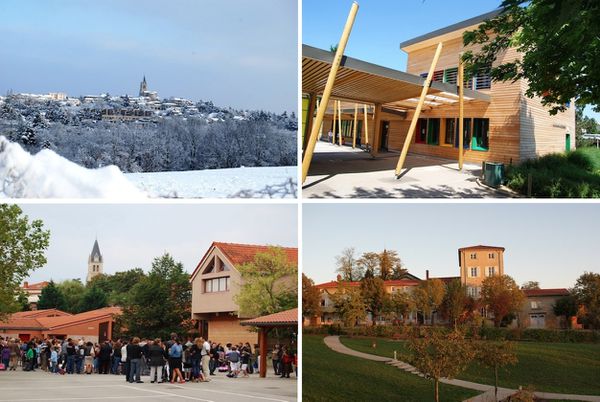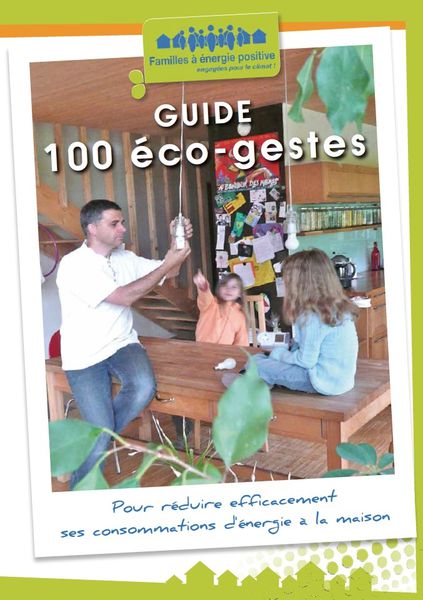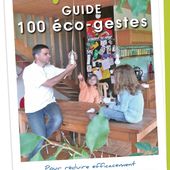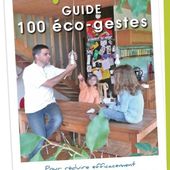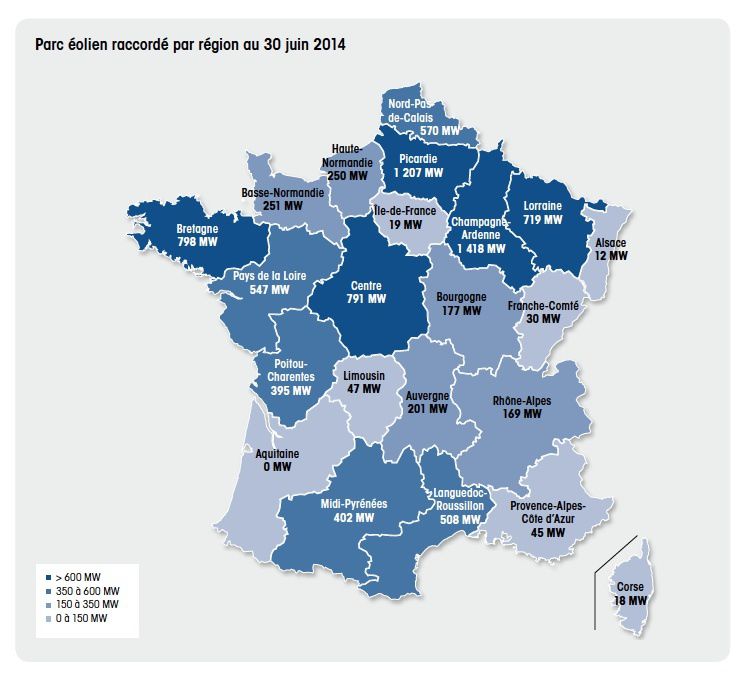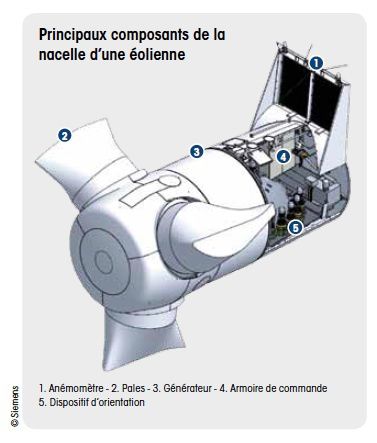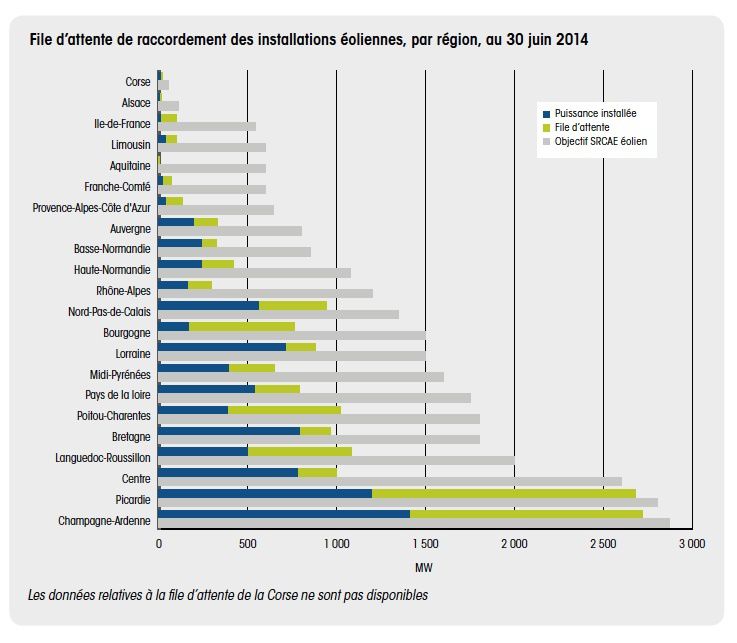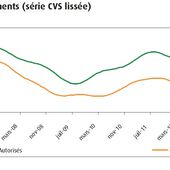Une augmentation des charges de 5,7% pour 2013 des charges de copropriétés
Oscar, l’Observatoire National des charges de copropriété de l’ARC, a constaté que , ce qui est légèrement inférieur à l’évolution de 2011 à 2012 (+6,1%) mais ce qui est bien supérieur à l’inflation des prix en 2013 (+0,9%).
C’est donc la 6ème année consécutive que publie les résultats de l’Observatoire National des charges de copropriété pour l’exercice 2013 sur Paris, l’Ile-de-France et les régions de la Province.
Le niveau national moyen des charges de copropriété par poste pour 2013 dépend de la configuration de la copropriété en matière de services collectifs. Ainsi pour une copropriété dotée de tous les services, le ratio annuel global est de 47 €/m2 et la répartition selon les principaux postes de dépenses est la suivante : chauffage (16,1 €/m2/an), personnel (8,7 €/m2/an), entretien (7,3 €/m2/an), frais de gestion (4,6 €/m2/an), eau froide (4,3 €/m2/an), ascenseur (2,7 €/m2/an), assurance (2,2 €/m2/an), parking (0,7 €/m2/an), impôts (0,4 €/m2/an).
En fonction de la localisation géographique, on obtient respectivement 51,5 €/m2/an pour Paris, 46,6 €/m2/an pour la région IDF hors Paris et 36,8 €/m2/an pour la Province. La différence entre Paris et le reste de l’IDF est d’environ 10%. Entre la Région Parisienne et la Province, l’écart est d’environ 25%.
Si l’on prend comme référence un appartement de 65 m2, on obtient un montant annuel de 3.055 € avec la répartition suivante :
- Chauffage : 1047 €
- Personnel : 566 €
- Entretien : 475 €
- Frais de gestion : 299 €
- Eau froide : 280 €
- Ascenseur : 176 €
- Assurance : 143 €
Les charges poste par poste
Chauffage et Eau chaude : +12,2%
Pour le chauffage, l’augmentation est essentiellement liée à un besoin plus important en 2013 de calories de chauffage d’après le bilan des DJU (degrés-jours-unifiés) (+8,5%) du fait d’un hiver plus rigoureux que l’année précédente. L’effet évolution des prix est moins important que l’année dernière et se situe à 1,8%.
« Il est encore trop tôt pour ressentir les effets des audits énergétiques réalisés entre 2012 et 2013, la plupart des copropriétés n’ont pas encore pris de décision sur l’engagement de gros travaux pouvant générer des économies d’énergie et donc une réduction des charges correspondantes », souligne Claude Pouey, responsable d'OSCAR.
Gardien/Employé d’Immeuble : +3,2%
De nombreuses copropriétés de moins de 50 lots ont supprimé le poste de gardien(ne), afin de réduire significativement leurs charges (de 30 à 50% d’économies sur ce poste). Elles font appel de plus en plus à des sociétés multiservices qui sont en capacité d’assurer une large gamme de petits travaux en plus des activités classiques de nettoyage et d’entretien des espaces verts.
« L'évolution des coûts est essentiellement dépendante de la politique salariale attachée à la Convention Collective Nationale des gardiens et employés d’immeuble ainsi, que des augmentations des salaires et des charges sociales liées en particulier à l’ancienneté de la population des gardiens(nes) », précise Claude Pouey.
Entretien et maintenance : +3,1%
On constate une augmentation en volume des dépenses d’entretien par rapport à l’exercice 2012. Ces dépenses résultent essentiellement du vieillissement des équipements et du bâti ce qui explique la croissance du nombre d’interventions engendrées par un mauvais entretien régulier du parc immobilier existant (problèmes d’étanchéité et de dégâts des eaux).
« Il y a également un effet prix du fait que les syndics ne prennent pas le temps ou ne sont pas en mesure de mettre en œuvre une vraie mise en concurrence et, ne négocient donc pas les devis proposés par les entreprises », explique Claude POUEY.
Il convient également de souligner que de plus en plus de travaux de sécurisation sont réalisés sur les copropriétés : contrôle d’accès, dispositifs de surveillance et d’alerte (caméras, alarmes)...
Frais d'administration et de gestion : +4,6%
Il ressort de l'analyse des comptes que les syndics continuent d’augmenter leurs honoraires de base, 2% cette année, et surtout facturent de plus en plus de prestations particulières (près de 15% d’augmentation cette année).
Pour l’ARC ce constat confirme que l’arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 n’a toujours pas généré de rupture par rapport aux pratiques abusives et illégales des syndics. « Certaines copropriétés supportent une augmentation très forte des honoraires de base de 30 à 50% du fait de la mise en œuvre des nouveaux contrats de syndic « tout compris », ce qui est excessif compte tenu que les prestations particulières représentent habituellement moins de 20% des frais de gestion de la copropriété », indique Claude POUEY.
Rappelons que l’ARC et l’UFC Que Choisir viennent de proposer un « contrat de syndic tout sauf » intégrant un maximum de prestations particulières et militent activement pour la publication du décret sur la limitation des prestations particulières prescrit par la loi A.L.U.R. du 24 mars 2014.
Eau froide et chaude (hors énergie) : +2.7%
L'évolution résulte essentiellement d’une augmentation des tarifs de fourniture de l’eau par les distributeurs et non des consommations qui sont relativement stables. L’augmentation est surtout sensible dans les copropriétés de la banlieue parisienne (petite couronne), qui en plus supportent des tarifs bien plus élevés qu’à Paris (35% d’écart par exemple entre les tarifs de SEDIF et ceux d’Eau de Paris).
Ascenseur : +2,5%
Il s'agit essentiellement de dépenses de maintenance qui ont diminué par rapport aux exercices précédents, une des conséquences de la réalisation de la première phase de mise en conformité des ascenseurs en termes de fiabilité et de disponibilité des équipements.
Assurance : +7,5%
Pour la troisième année consécutive, ce poste a fortement augmenté. Le taux d'évolution est la résultante de deux composantes : le taux de sinistralité national qui a progressé d'environ 5% et le taux de sinistralité propre à chaque copropriété. Ce dernier ne cesse d'évoluer du fait du vieillissement du bâti, qui génère de nombreux sinistres.
Parkings : +2,9%
L’évolution résulte essentiellement des dépenses d'entretien et de maintenance des équipements de contrôle et de sécurisation des accès aux parkings, ainsi que des travaux de remise en état et de renforcement de la sécurité des parkings.
Les résultats fournis par OSCAR, l'Observatoire National des charges de l'ARC, sont directement exploitables par les responsables de copropriétés et les syndics bénévoles, pour évaluer la performance des dépenses supportées par leur propre résidence. « Cette année, les copropriétaires ont la possibilité d’obtenir en ligne, grâce à OSCAR +, une étiquette charges fournissant une évaluation allant de A à G, une étiquette chauffage, ainsi qu’un diagnostic de performance des charges de leur copropriété, dispositif qui s’apparente à celui du DPE (Diagnostic de Performance Energétique) », conclut Claude POUEY.