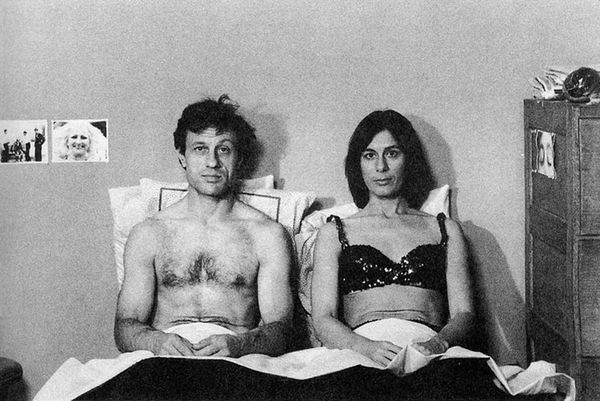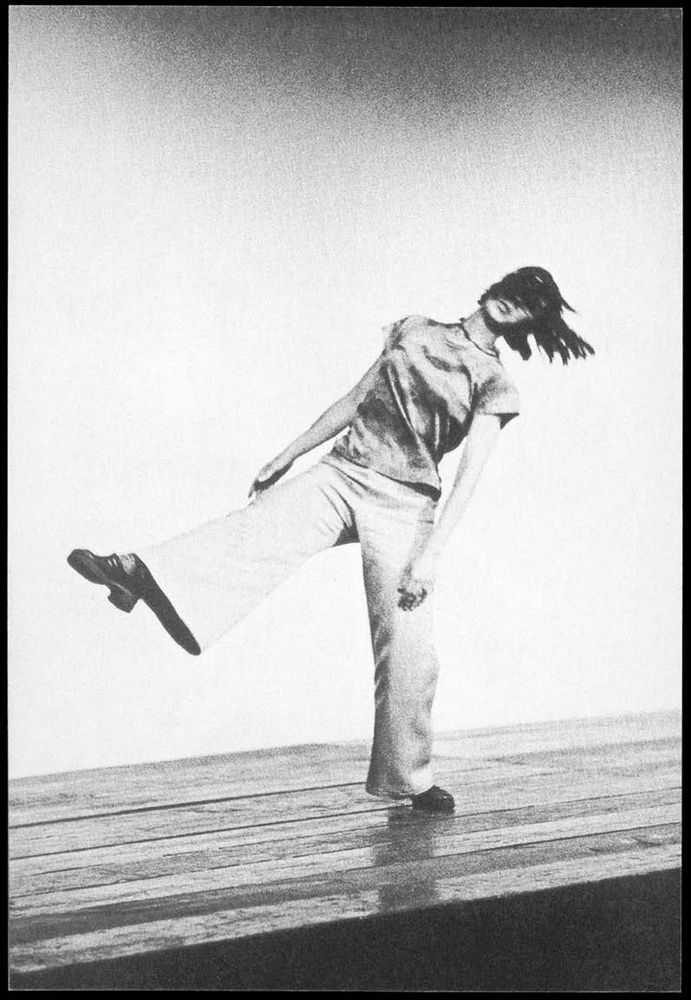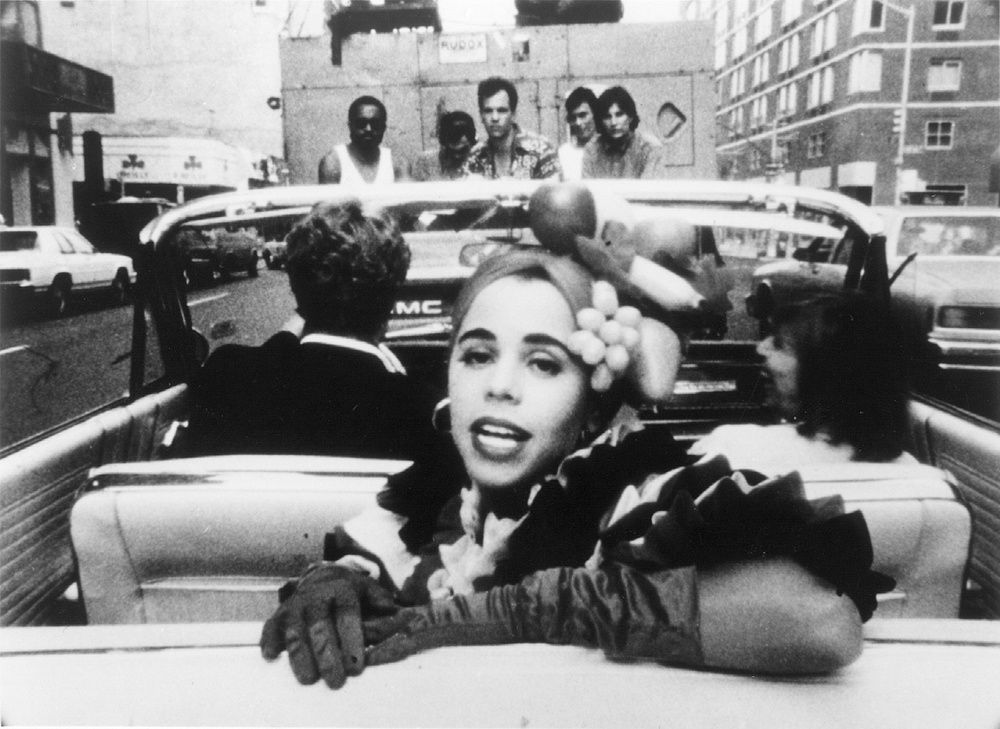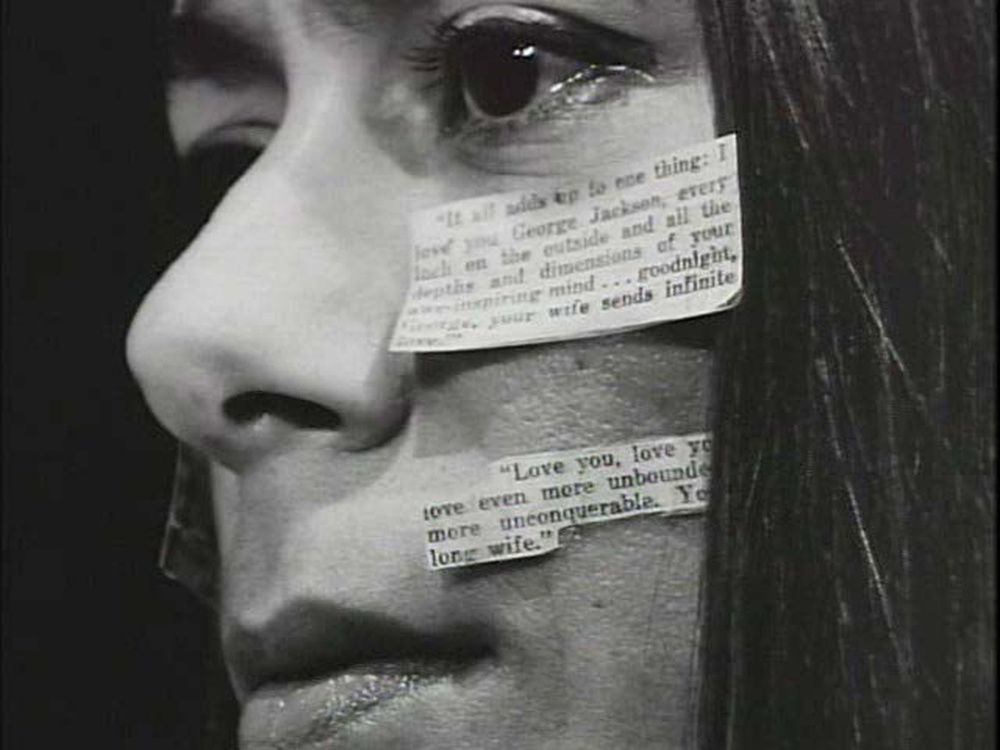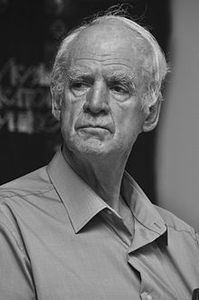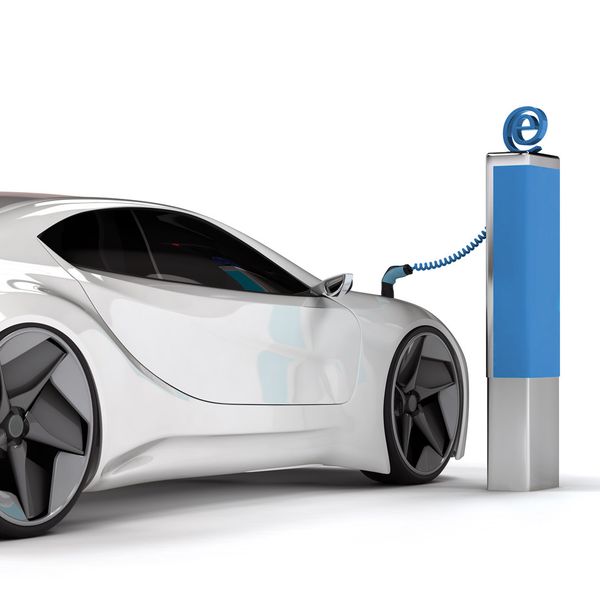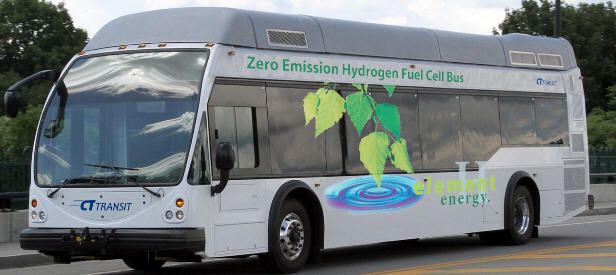Habitat Participatif, l'article 22 de la Loi ALUR
Même si le présent article reprend dans ses grands principes celui publié en juin 2013, il se penche plus précisément sur l’article 22 de la loi ALUR qui intéresse particulièrement l’Habitat Participatif car il offre un cadre légal pour celui-ci, en reconnaissant son existence aux yeux de la loi, des banques, des notaires, et de tous les partenaires.
Le chapitre VI, article 22, du projet de loi, crée les Sociétés d’habitat participatif qui pourront prendre deux formes juridiques:
– les coopératives d’habitants
– les sociétés d’attribution et d’autopromotion
Ces deux types de sociétés visent à créer un cadre juridique permettant à des personnes ou des ménages de se regrouper, éventuellement avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure de ces immeubles.
Il s’agit d’une démarche citoyenne dans une logique de partage et de solidarité entre habitants.
Les futurs habitants ont la qualité d’associés et acquièrent donc au préalable des parts sociales de ces sociétés.
Ces sociétés peuvent admettre, outre les associés personnes physiques, des personnes morales détenant au maximum 30% du capital social (il peut s’agir d’un organisme HLM, d’une société d’économie mixte ou d’un organisme agréé) : il leur sera attribué un nombre de logements proportionnel à leur participation dans le capital social de la société.
Les sociétés préexistantes (SCIA ou SCCC) peuvent, si elles le désirent, adopter ces nouveaux statuts.
Une société doit limiter son projet àun seul programme dans un même ensemble immobilier (éventuellement en plusieurs tranches).Avant le commencement des travaux, la société doit fixer les bases techniques et financières du projet, la répartition des coûts. Chaque société doit justifier d’une garantie d’achèvement de l’immeuble afin de sécuriser l’opération de construction. Les conditions de cette garantie seront définies par un décret en Conseil d’Etat.
LES COOPERATIVES D’HABITANTS : L’objet social de ces sociétés est de :
- fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence principale (un décret précisera les conditions dérogatoires),
- entretenir et animer des lieux de vie collective,
- ouvrir la possibilité d’offrir des services à des tiers, associés ou non associés, dans un cadre défini (par décret en Conseil d’Etat),
- prévoir la conclusion d’un contrat coopératif entre la coopérative et chaque associé, ainsi que les modalités de sa cessation.
Le contrat coopératif détermine les conditions de jouissance de chaque associé, ainsi que le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat précise à ce titre :
- la fraction locative correspondant à la jouissance du logement,
- la fraction acquisitive correspondant à l’acquisition de parts sociales.
Le mode de répartition des charges des services collectifs et équipements communs est adopté en assemblée générale. Il donne lieu à un règlement annexé au contrat coopératif.
Le prix de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité selon des principes décrits dans les statuts.
LES SOCIETES D’ATTRIBUTION ET D’AUTOPROMOTION :
L’objet social de ces sociétés est d’attribuer à leurs associés la jouissance ou la propriété d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les espaces et locaux collectifs partagés qui y sont attachés.
Un état descriptif de division décrit les lots qui constituent l’ensemble immobilier : certains lots sont à usage privatif (les logements) et d’autres lots sont à usages partagés (les locaux et espaces communs partagés). Les lots sont affectés aux parts sociales : acte d’« attribution des lots aux parts ».
Dès la constitution de la société, les statuts optent soit pour l’attribution en jouissance soit pour l’attribution en propriété :
- Dans le cas de l’attribution en jouissance la société est pérenne. Un règlement en jouissance délimite les diverses parties de l’immeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.
– Dans le cas d’attribution en propriété un règlement de copropriété précise la destination des parties réservées à l’usage privatif des associés et celle des parties communes affectées à l’usage de tous les associés ou de plusieurs d’entre eux. Ce règlement de copropriété est annexé aux statuts. Dans ce cas d’attribution en propriété, la société d’autopromotion est dissoute (à la fin des travaux par exemple) : elle devient alors une copropriété.
Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens attribués (en jouissance ou en propriété) en tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.
Les associés participent aux charges des espaces communs et locaux partagés proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans leurs lots, selon la quote-part reprise dans le règlement de jouissance ou le règlement de copropriété
Lors des décisions concernant la gestion ou l’entretien de l’immeuble, chaque associé vote selon un mode déterminé dans les statuts :
- soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social.
- soit chaque associé dispose d’une voix : il s’agit alors d’une gérance coopérative, dans laquelle « un homme = une femme = une voix », indépendamment de la taille du logement qu’il occupe.
Ce chapitre de loi a été élaboré à partir d’ateliers ministériels réunissant pendant plusieurs mois de nombreux représentants institutionnels ainsi que des délégués des associations d’habitants composantes de la Coordin’action.