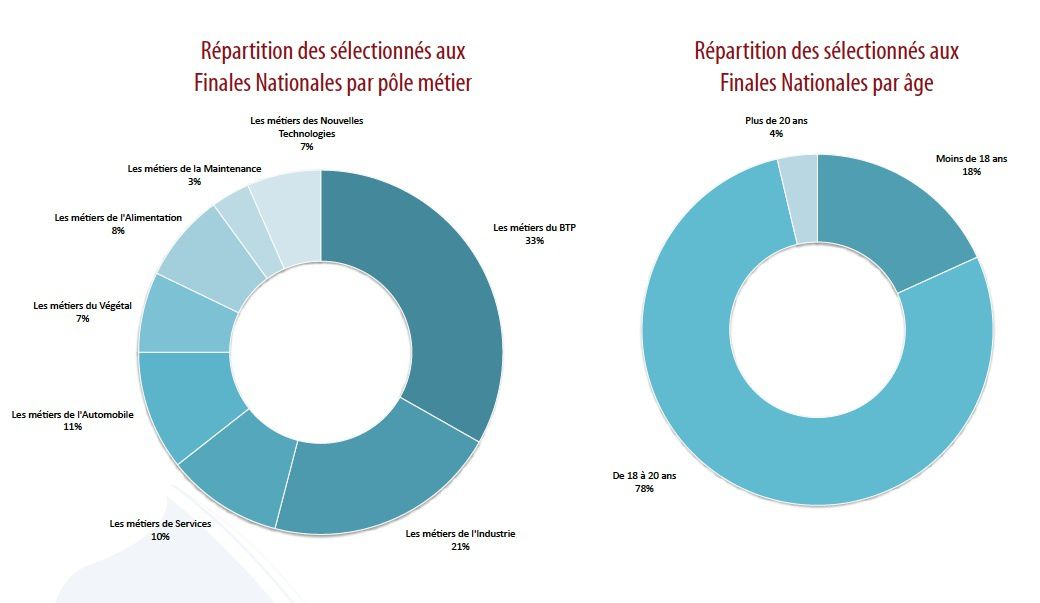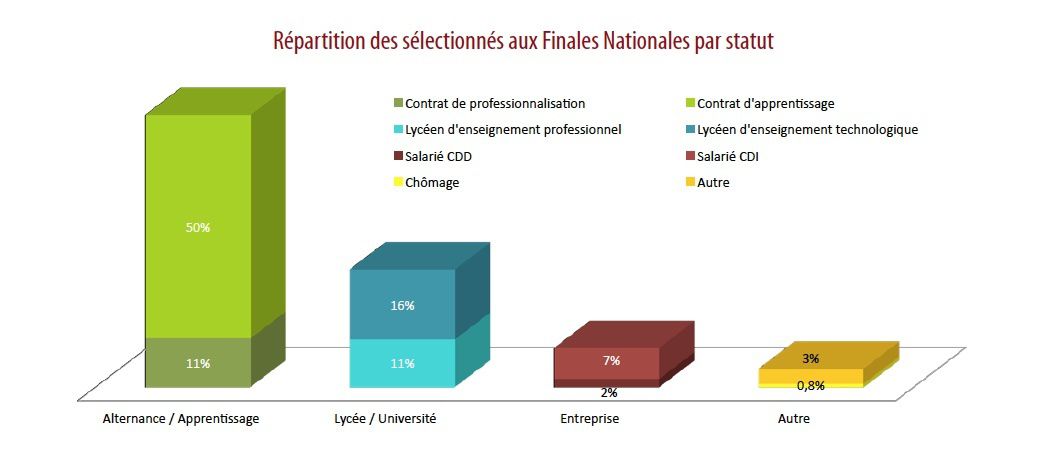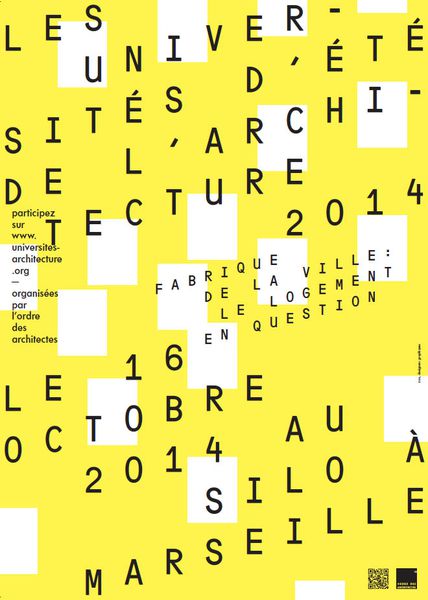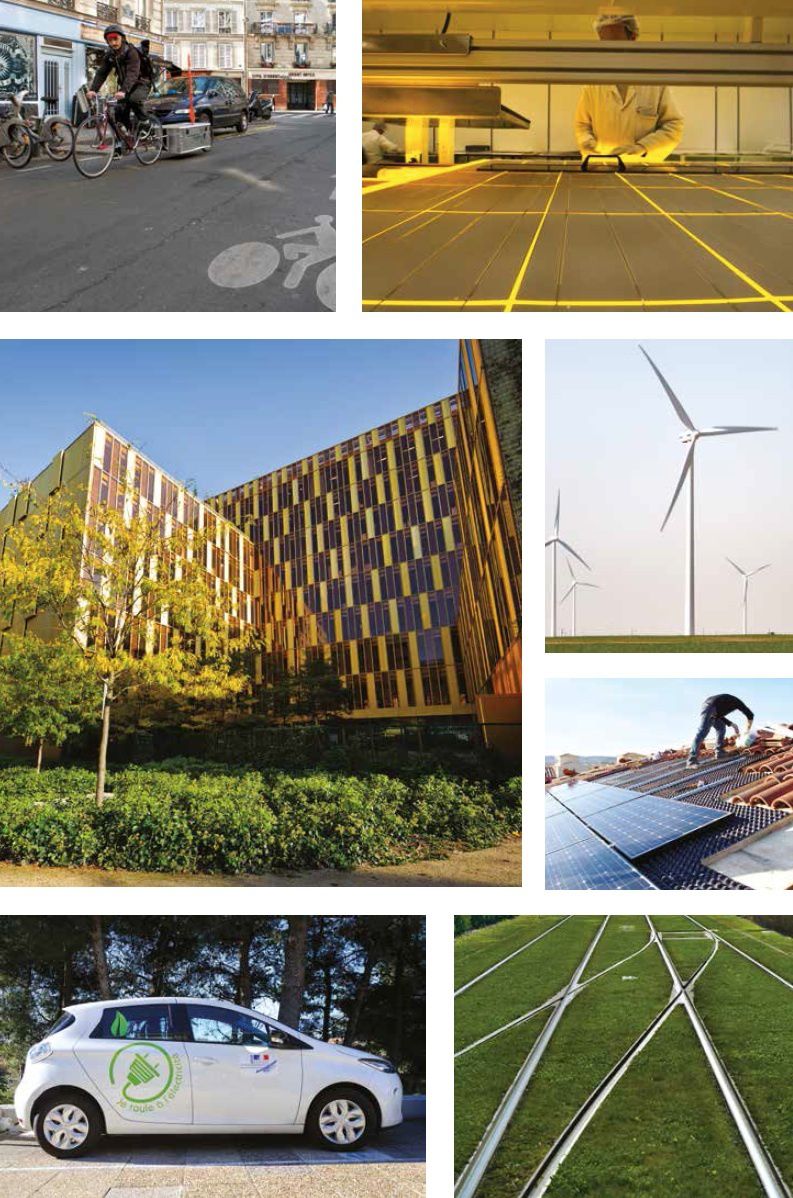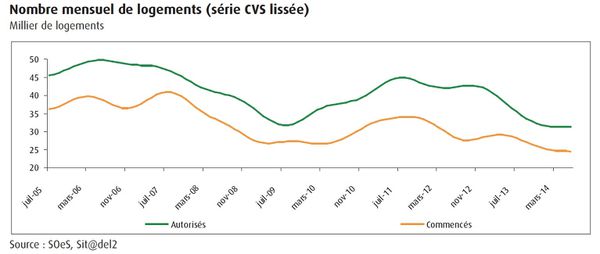LES OEUVRES PRÉSENTÉES DANS LE SALON
Tableaux
- La Magnificence royale par Claude III Audran (1658-1734).
- Louis de France, dit le Grand Dauphin (1661-1711) ; fils de Louis XIV devant le siège de Philipsbourg en 1688 par l’atelier de Rigaud.
- Louis de France, duc de Bourgogne (1662-1712) l’aîné des petits-fils de Louis XIV par l’atelier de Rigaud.
- Philippe V, roi d’Espagne (1683-1746) deuxième petit-fils de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud.
- Louis XV, roi de France (1710-1774), arrière-petit-fils de Louis XIV par Jean- Baptiste Van Loo.
Nature morte au chandelier des Travaux d’Hercule et Nature morte aux pièces de l’orfèvrerie de Louis XIV par Meiffren Comte (1630-1705).
Mobilier
- Deux Médailliers en marqueterie de première partie de cuivre sur fond d’écaille et de contrepartie d'écaille sur fond de cuivre probablement de l’atelier de Boulle et de ses fils, premier tiers du XVIIIe siècle, Saisie révolutionnaire.
- Deux médailliers de style Boulle vers 1770 en marqueterie de contrepartie d’écaille sur fond de cuivre, attribué à Philippe-Claude Montigny, maître en 1766, don Roudinesco.
- Deux commodes par André-Charles Boulle (1642-1732), ébène, marqueterie de première partie de cuivre sur fond d’écaille pour la chambre du roi à Trianon. Exécutées en 1708.
- Paire de guéridons « porte-girandole », bois sculpté et doré, XVIIIe siècle.
- Paire de guéridons « porte-girandole », bois sculpté et doré, XIXe siècle, legs de la duchesse de
Windsor en souvenir de S.A.R. le duc de Windsor.
- Quatre girandoles «à lacé » en bronze doré et cristal de roche de style Louis XIV.
Petites sculptures en marbre et en bronze de la collection de Louis XIV
- Annius Verus, buste antique, marbre
- Italie, XVIIe siècle, Le Gladiateur Borghèse, statuette, bronze. Don de Le Nôtre à Louis XIV en 1693 ; n° 201 des Bronzes de la Couronne ; œuvre attestée à Versailles en 1707. Paris, Musée du Louvre, département des objets d’art, en dépôt à Versailles.
- Cérès, tête antique, marbre. Œuvre attestée à Versailles en 1707.
- Italie-XVIe siècle, Néron, buste, bronze. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, MR 1691 ; en dépôt à Versailles.
- Italie-XVIe siècle, Poppée Sabine, buste, bronze. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.
- Italie-XVIIe siècle, Vénus accroupie, statuette, marbre. Don d’Hippolyte de Béthune à Louis XIV en 1663 ; œuvre attestée à Versailles en 1707.
- Italie-XVIIe siècle, Porcie, statuette, marbre. Don d’Hippolyte de Béthune à Louis XIV en 1663 ; œuvre attestée à Versailles en 1707 ; mentionnée dans le cabinet des Médailles en 1720.
- Italie-XVIIe siècle, Le Tireur d’épine, statuette, marbre. Don d’Hippolyte de Béthune à Louis XIV en 1663 ; œuvre attestée à Versailles en 1707.
- Italie-XVIe siècle, Apollon, statuette, bronze. N° 242 des Bronzes de la Couronne.
- Rome-XVIIe siècle, Vestale, tête, bronze. Legs de Charles Errard à Louis XIV en 1689 ; n° 309 des Bronzes de la Couronne ; œuvre attestée à Versailles en 1707. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.
- Florence-XVIIe siècle, d’après Jean de Bologne, L’Astronomie, statuette, bronze. N° 66 des Bronzes de la Couronne.
- Italie-XVIIIe siècle, Caracalla, buste, bronze. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.
- Italie-XVIIe siècle, Anacréon, buste, bronze. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.
- Rome-XVIIe siècle, Socrate, tête, bronze. Legs de Charles Errard à Louis XIV en 1689 ; n° 195 des Bronzes de la Couronne ; œuvre attestée à Versailles en 1707. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.
- Italie-XVIIe siècle, Amour chevauchant un cheval marin, groupe, marbre. Œuvre attestée à Versailles en 1707.
- Rome-XVIIe siècle, Antinoüs, tête, bronze. Legs de Charles Errard à Louis XIV en 1689 ; n° 213 des Bronzes de la Couronne ; œuvre attestée à Versailles en 1707. Paris, Musée du Louvre, département des sculptures, en dépôt à Versailles.