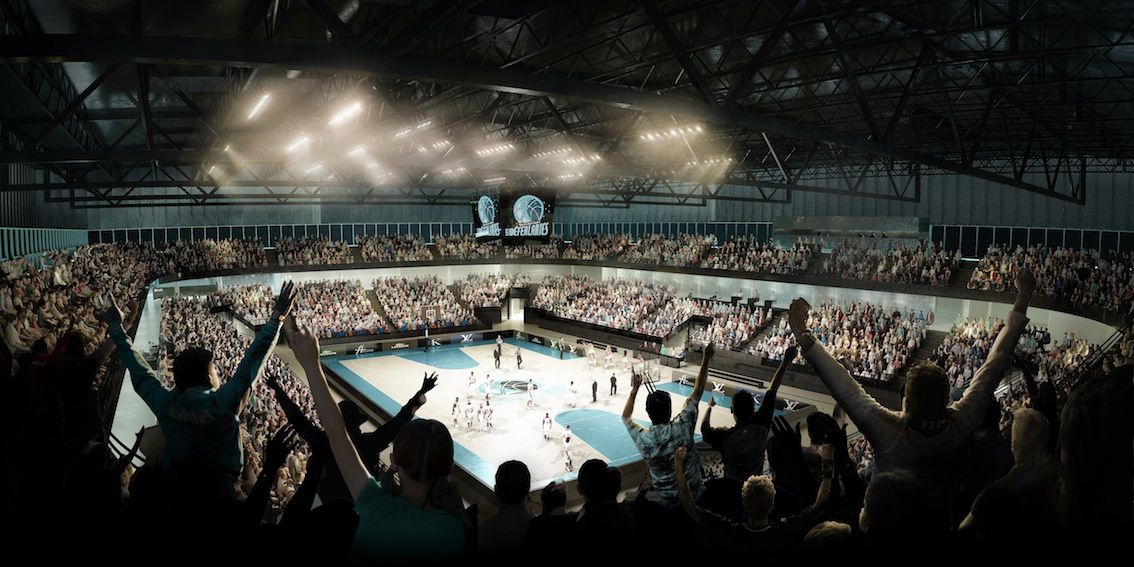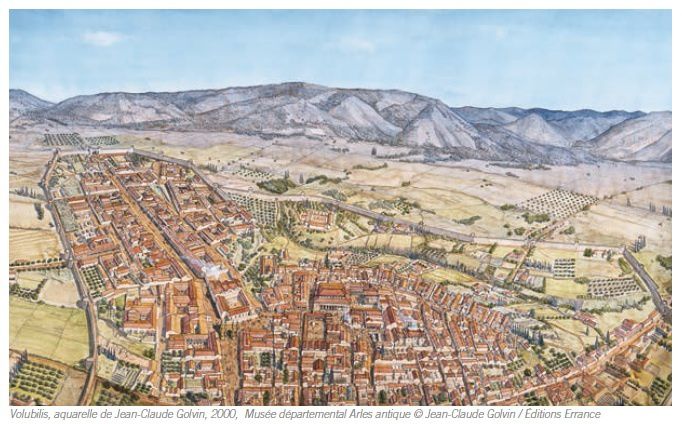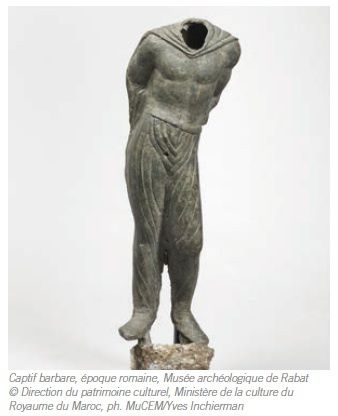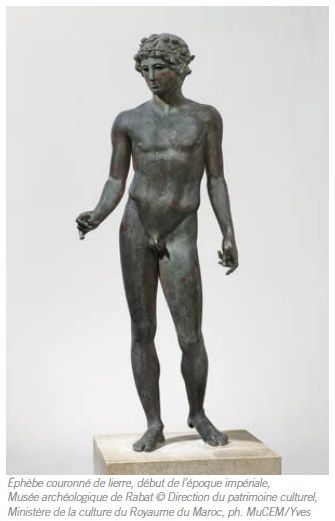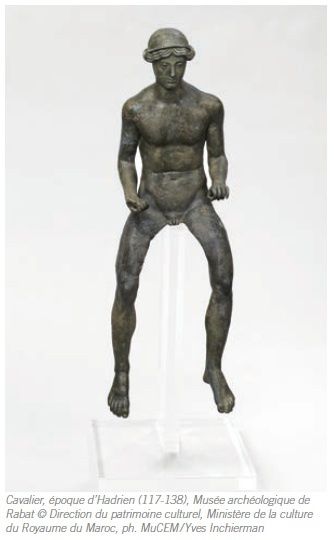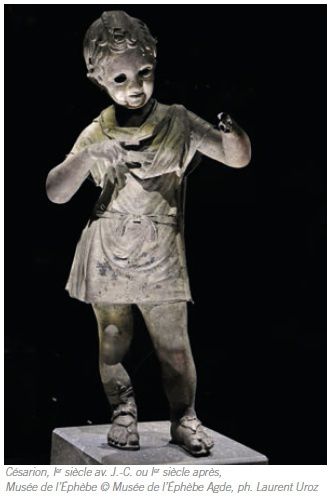Principaux textes
INTERDICTION DU TRAVAIL DISSIMULE :
Article L.8221-1 du code du travail
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par les articles L.8221-3 et L.8221-5, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
DEFINITION DU TRAVAIL DISSIMULE :
Article L.8221-3 du code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Article L.8221-5 du code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
DEFINITION DU TRAVAIL ILLEGAL :
Article L.8211-1du code du travail
Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; 5° Cumuls irréguliers d'emplois ; 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L.5124-1, L.5135-1 et L.5429-1.
ACTIVITES PRESUMEES A TITRE LUCRATIF :
Article L.8221-4 du code du travail
Les activités mentionnées à l'article L.8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; 3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
DROITS DU SALARIE :
Article L.8223-1du code du travail
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Article L.8223-2 du code du travail
Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
FLAGRANCE SOCIALE :
Article L.243-7-4 du code de la sécurité sociale
Dès lors qu'un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l'inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l'évaluation du montant des cotisations dissimulées.
Ce procès-verbal est signé par l'inspecteur et par le responsable de l'entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est conservé par l'organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.
Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l'une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles 74 à 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
CONTRÔLE :
Article L.8271-7 du code du travail
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2.
Article L.8271-1-2 du code du travail
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
Article L.8271-8 du code du travail
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès- verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Article L.8271-8-1du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès- verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
Article L.8271-9 du code du travail
Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :
1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
2° Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L.8221-1 ou L.8221-4, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L.8221-3 ou L.8221-5 ou des règlementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L.8221-1.
Article L.8271-10 du code du travail
Les agents mentionnés de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée
Article L.8271-6-1 du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse
Article L.8271-3 du code du travail
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'œuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
DROIT DE COMMUNICATION :
Article L.8271-2 du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
Article L.8271-4 du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Article L.8271-5 du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre premier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.
Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées
Article L.8271-6 du code du travail
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en œuvre de ces échanges.
Article L.114-15 du code de la sécurité sociale
Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L.325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d’un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en œuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1- 14 et L.323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l’assurance chômage, afin de mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles L.351-17 et L.365-1 du code du travail.
Article L.114-16 du code de la sécurité sociale
L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Article L 114-19 du code de la sécurité sociale
Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L.243-7 du présent code et L.724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L.324-12 du code du travail ;
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 7 500 euros.
Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
SOLIDARITE FINANCIERE :
Article L243-15 du code de la sécurité sociale
Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.
Article D243-15 du code de la sécurité sociale
Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13.
La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.
Article L.8222-1du code du travail
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Article L.8222-2 du code du travail
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès verbal pour délit travail dissimulé :
1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3o Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Article L.8222-3 du code du travail
Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 du code du travail sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Article L.243-7-3 du code de la sécurité sociale
Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.233-1 et L.233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat.
SOUS-TRAITANT EN SITUATION IRREGULIERE :
Article L.8222-5 du code du travail
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L.8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1o à 3o de l'article L.8222-2, dans les conditions fixées à l'article L.8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Article L.8222-6 du code du travail
Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3
ANNULATION DES EXONERATIONS DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE :
Article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Art. R.133-8 du code de la sécurité sociale
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale
Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
MAJORATION DU REDRESSEMENT DE 25% EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULE ;
Article L. L243-7-7 du code de la sécurité sociale
Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
SUPPRESSION DES AIDES A L'EMPLOI :
Article L8272-1 du code du travail
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal.
Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement.
Article D.8272-1 du code du travail
Pour l'application de l'article L.8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :
1° Contrat d'apprentissage ;
2° Contrat unique d'insertion ;
3° Contrat de professionnalisation ;
4° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et- Miquelon ;
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L.1511- 1 à L.1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
Article D.8272-2 du code du travail
Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D.8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.
FERMETURE ADMINSTRATIVE :
Article L8272-2 du code du travail
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131- 39 du code pénal.
La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
SANCTIONS PENALES :
Article L.8224-1 du code du travail
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
Article L.8224-3 du code du travail
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L.8224-1 et L.8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
CONDAMNATION DES PERSONNES MORALES :
Article L.8224-5 du code du travail
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L.8224-1 et L.8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1o à 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
MARCHES PUBLICS :
Article 46 du code des marchés publics
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Arreté du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude
Siègent au sein des comités de lutte contre la fraude mentionnés au titre II du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans chaque département :
- les procureurs de la République du département ou leurs représentants ;
- les chefs de services préfectoraux compétents en matière de lutte contre la fraude ;
- les autorités compétentes de la police nationale ;
- les autorités compétentes de la gendarmerie nationale ;
- les autorités compétentes de la direction générale des finances publiques ;
- les autorités compétentes de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- les directeurs des organismes locaux de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et du régime agricole ou leurs représentants ;
- un responsable coordonnateur désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
- dans les départements de la région Ile-de-France, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un représentant du préfet de police.